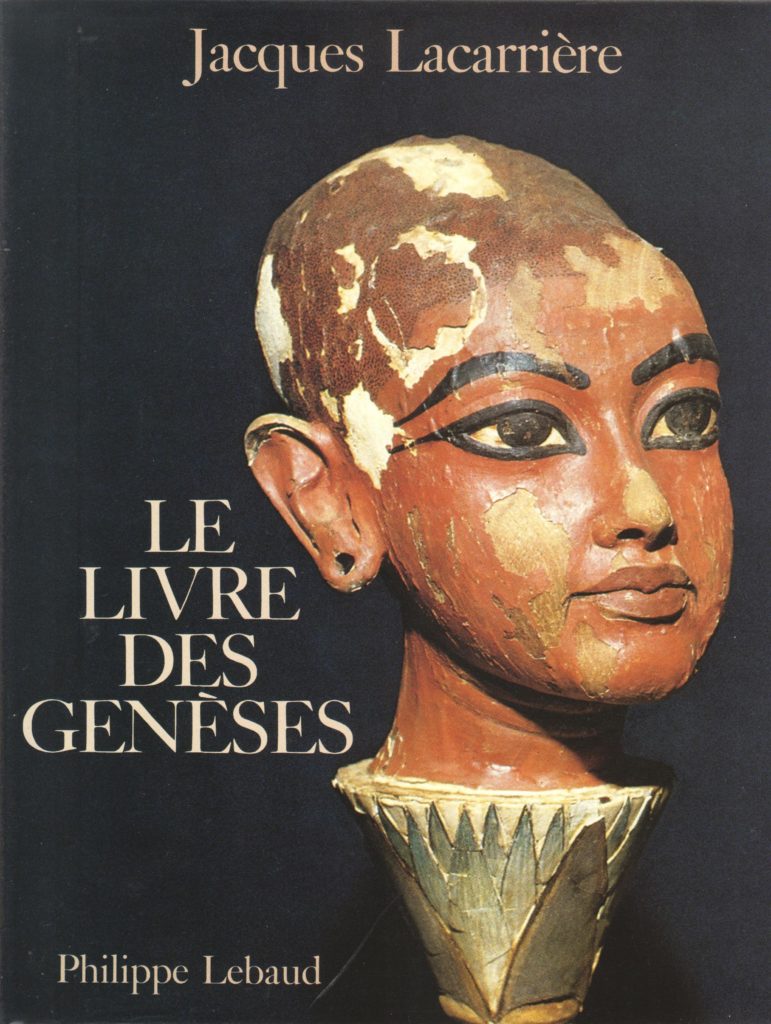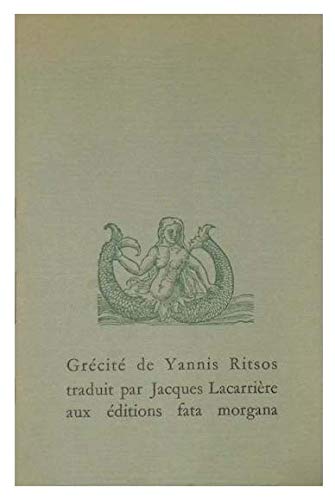Claude Roy, le Monde, le Nouvel Obs, 2 décembre 1968.
Quand on cherche à connaître la littérature grecque moderne, à laquelle se dévouent des spécialistes remarquables, comme Chrysa Papandréou, Gérard Pierrat, Antoine Vitez, il y a un ami qui se retrouve à tous les carrefours essentiels, le nom d’un homme modeste et d’un talent éclatant : Jacques Lacarrière. J’ai trop souvent ici l’irritante occasion de dénoncer les méfaits des traducteurs-trahisseurs, des saccageurs de grands textes. Il me semble juste, pour une fois, de saluer comme il le mérite, un traducteur modèle et un écrivain rigoureux.
Jacques Lacarrière publie en effet simultanément, la traduction d’un auteur grec qui courait les grand-routes du monde il y a vingt-cinq siècles environ, et celle de Grécité, de Ritsos. Le premier ethnographe de la Grèce antique, Hérodote et le premier poète de la Grèce actuelle, Yannis Ritsos, viennent à nous, grâce à Lacarrière, avec la même fraîcheur, la même immédiateté. Qu’il traduise d’une langue morte ou du néo-grec, qu’il étudie et traduise les tragiques, qu’il explore les œuvres des « Hommes ivres de Dieu », les Pères du Désert de l’Egypte hellénique, qu’il découvre et ressuscite de savoureux manuscrits alexandrins du IIIe siècle, comme la « Vie légendaire d’Alexandre le Grand », rédigée par le pseudo-Callisthène sept siècle après la mort du Macédonien, et enrichie d’interpolations pendant tout le Moyen Age byzantin et turc, qu’il révèle au public français l’œuvre de Georges Séféris ou celle de Yannis Ritsos, ou du jeune romancier Vassili Vassilikos : avec Lacarrière, une traduction n’est jamais une de ses « belles infidèles », dont on est tenté de dire qu’il ne leur manque que la parole, parce que la parole que leur donne l’interprète est figée ou pauvre, glacée ou approximative.
Pourquoi un texte grec ancien ou moderne traduit par l’auteur des « Promenades dans la Grèce antique » donne-t-il toujours un sentiment si fort de vérité et de vivacité ? Sans que pourtant l’auteur de ces versions soit suspect de consentir à des libertés coupables ou à des complaisances faciles. Car jamais Lacarrière ne cède à la tentation de « rapprocher » complaisamment de nous Hérodote ou Jean Climaque en utilisant des anachronismes volontaires, des modernismes douteux, des « familiarités discutables », l’attirail de ruses un peu grosses qui donnent à peu de frais l’impression que « cela a été écrit hier ». Un texte établi et traduit par lui l’est toujours avec rigueur. Ce franc-tireur de l’hellénisme contemporain a l’élégance de dissimuler toujours le travail très probe du savant et du philologue, de rendre invisible le soubassement de critique scientifique, d’érudition minutieuse, d’analyse linguistique sur quoi se fondent ses travaux.
Le secret de Jacques Lacarrière, c’est sans doute que lui-même en sort tout le premier. Il sait tout ce qu’on peut apprendre dans les bibliothèques, à la Sorbonne, ou en mettant en scène et en jouant les tragiques grecs. Mais il sait aussi tout ce qu’on ne peut pas y apprendre. Quand il écrit sur les Pères du Désert, c’est en homme qui a dépouillé de vieux manuscrits, la Patrologie et la Philocalie, mais qui a vécu aussi des saisons entières en partageant la vie des moines et des ermites solitaires du mont Athos. Quand il nous invite à parcourir la Grèce, il a traduit pour cela les itinéraires de Pausanias, mais il a aussi parcouru à pied l’Attique et l’Arcadie, il a grimpé pendant des heures au sommet du Parnasse avec le garde-champêre de Delphes, exploré avec lui la grotte Corycienne où il peut comparer ce qu’il découvre avec ce qu’a décrit Pausanias.. Quand il traduit les romanciers et les poètes grecs, il a traîné comme eux dans les rues d’Athènes ou les ruelles des villages, dormi sur la plage avec les pêcheurs, respiré les mêmes odeurs, mangé le même pain, chanté les mêmes chansons.
Sous l’écorce de ce Bourguignon sorti d’une toile flamande, avec sa tête de donateur d’un retable primitif, il y a un rat de bibliothèque qui connaît tous les livres et un coureur de grands chemins dont la chair n’est pas triste. Ce que Maurice Coindreau et Pierre Leyris ont été pour les écrivains anglo-saxons, ce que Baudelaire fut pour Poe, ce que Michèle Loi est pour les poètes chinois, Jacques Lacarrière l’est pour les Grecs d’autrefois, et pour les vivants : mieux qu’un interprète, plus qu’un médiateur, davantage qu’un traducteur – un compagnon, un frère.