à retrouver sur son site
Chemin faisant
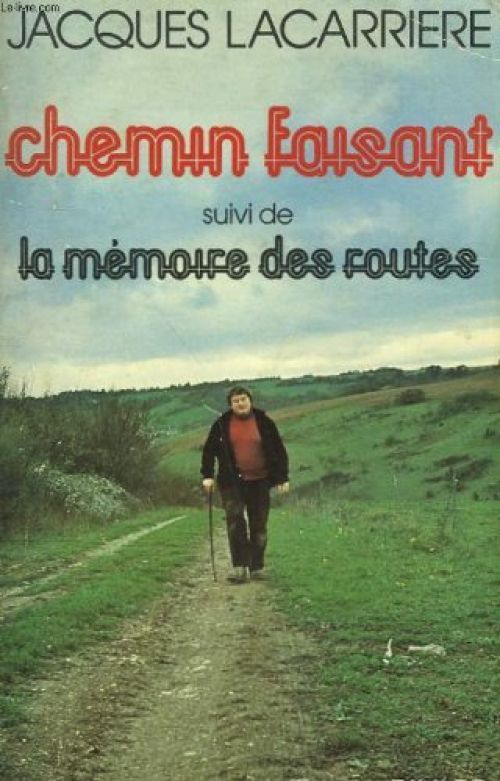
» Rien ne me paraît plus nécessaire aujourd’hui que de découvrir ou redécouvrir nos paysages et nos villages en prenant le temps de le faire. Savoir retrouver les saisons, les aubes et les crépuscules, l’amitié des animaux et même des insectes, le regard d’un inconnu qui vous reconnaît sur le seuil de son rêve. La marche seule permet cela. Cheminer, musarder, s’arrêter où l’on veut, écouter, attendre, observer. Alors, chaque jour est différent du précédent, comme l’est chaque visage, chaque chemin.
» Ce livre n’est pas un guide pédestre de la France, mais une invitation au vrai voyage, le journal d’un errant heureux, des Vosges jusqu’aux Corbières, au coeur d’un temps retrouvé. Car marcher, c’est aussi rencontrer d’autres personnes et réapprendre une autre façon de vivre. C’est découvrir notre histoire sur le grand portulan des chemins. Je ne souhaite rien d’autre, par ce livre, que de redonner le goût des herbes et des sentiers, le besoin de musarder dans l’imprévu, pour retrouver nos racines perdues dans le grand message des horizons. «
Jacques Lacarrière
Fayard 1977, 1985, 1993, 1997, 2005
ISBN 978-2213004334
Flâner en France
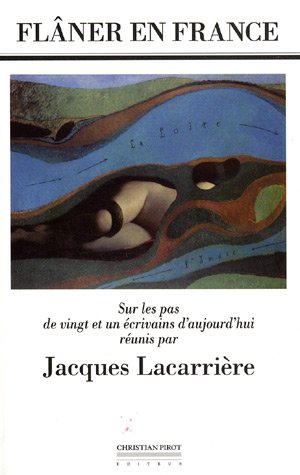
Les auteurs réunis dans Flâner en France sont tous contemporains et appartiennent à toutes les régions. C’est pourquoi à travers ce recueil vous pourrez visiter la Beauce avec Marianne Auricoste, le Maçonnais avec Gérard Bialestowski, la Thié-rache avec Jacques Darras, le cours du Serein en Bourgogne avec Pascal Dibie, celui de la Dordogne avec Alain Glykos, le Périgord et la Vézère avec Simonne Jacquemard, les hautes Cévennes avec Gil Jouanard, la forêt de Tronçais avec Jacques Lacarrière, la Creuse avec Jacques Meunier, le Beaujolais avec Martine Courtois, les chemins de Montmartre à Saint-Denis avec Bernard Noël, la Champagne avec Louis Nucéra, les Causses avec Jean-Pierre Otte, l’Alsace avec Gilles Pudlowski, le pays de Proust avec Jacques Réda, la Flandre avec Jean Rolin, l’Aubrac avec Jean-Loup Trassard, la Saintonge avec Jean-Claude Valin, l’Eure-et-Loir avec Jean Guiloineau, la Bourgogne avec Maria Maïlat. Vous pourrez aussi découvrir les errances de Luis Mizon. C’est une France tout à fait insolite, surprenante même mais aussi lyrique, attachante qui surgit de ces regards différents mais toujours passionnés.
De l’Alsace à la Saintonge, de la frontière belge à l’Aubrac -et même de Montmartre à St-Denis -, voici une France visitée ou revisitée par dix-huit écrivains. Revisitée et réapprise selon les seules exigences des chemins, des désirs et de la liberté. Retrouvée à travers sentiers, villages, cafés, restaurée en sa mémoire enfouie, en ses beautés dormantes, oui, des fragments de France réassemblés au terme de retrouvailles et de quêtes intimes. Tout le contraire en somme du voyage touristique et du dépaysement. Certains de ces textes, relatant un retour vers des lieux d’enfance, sont même de véritables repaysements. Des réajustements, des réemplois de mémoires et d’émois. Ces rencontres avec des lieux qu’habite une image incertaine mais encore vivante de soi-même ont souvent des humeurs et des rumeurs d’aveux. Aveux d’admiration, d’émerveillement, d’amour, d’agacement aussi ou de morosité. Autant de réactions révélant les facettes de ces terroirs à retrouvailles, où la vérité d’autrefois se cherche dans le leurre de l’aujourd’hui. Et ce qui émane de ces fêtes ou de ces déceptions de la mémoire, ce sont des relations singulières au sens fort du mot singulier : ce qui est fortement individualisé, scandaleusement subjectif, outrancièrement intime. Car c’est dans l’intime de chacun, s’il est poreux aux messages du monde, que l’on retrouve le mieux le chant du collectif.
On ne trouvera donc, et je m’en félicite, aucun pittoresque en ces textes soufflés, susurrés ou dictés par le vent des chemins, aucun spectaculaire à terreurs ou frissons mais des ferveurs, des chuchotements, des élans, des émois, des aveux, des rages aussi et des orages devant le désolant spectacle d’une nature que l’on assassine. A noter – car c’est très important – qu’on ne trouvera en ces pages où dialoguent tour à tour le vent, les herbes, les oiseaux, les arbres, les pêcheurs, les braconniers et les maçons aucune nostalgie, ni sentiment «rétro», aucun appel à un quelconque retour aux sources et encore moins un besoin de folklore.
Les auteurs réunis dans Flâner en France sont tous contemporains et appartiennent à toutes les régions. C’est pourquoi à travers ce recueil vous pourrez visiter la Beauce avec Marianne Auricoste, le Maçonnais avec Gérard Bialestowski, la Thié-rache avec Jacques Darras, le cours du Serein en Bourgogne avec Pascal Dibie, celui de la Dordogne avec Alain Glykos, le Périgord et la Vézère avec Simonne Jacquemard, les hautes Cévennes avec Gil Jouanard, la forêt de Tronçais avec Jacques Lacarrière, la Creuse avec Jacques Meunier, le Beaujolais avec Martine Courtois, les chemins de Montmartre à Saint-Denis avec Bernard Noël, la Champagne avec Louis Nucéra, les Causses avec Jean-Pierre Otte, l’Alsace avec Gilles Pudlowski, le pays de Proust avec Jacques Réda, la Flandre avec Jean Rolin, l’Aubrac avec Jean-Loup Trassard, la Saintonge avec Jean-Claude Valin, l’Eure-et-Loir avec Jean Guiloineau, la Bourgogne avec Maria Maïlat. Vous pourrez aussi découvrir les errances de Luis Mizon. C’est une France tout à fait insolite, surprenante même mais aussi lyrique, attachante qui surgit de ces regards différents mais toujours passionnés.
Saint-Cyr-sur-Loire, Editions Christian Pirot, 1987, 2007
ISBN 978-2868082510
L’envol d’Icare
Suivi du Traité des chutes, accompagné d’une lettre à Icare et d’un Pèlerinage à l’île d’Icaria

Homme-oiseau nanti d’ailes artificielles, premier aéronaute de l’espace, shaman ou initié appelé à monter au ciel, homme-papillon qui se brüle au soleil, avorton volant, homme-émissaire sacrifié et précipité dans le vide, homme volatil et sublimé, utopiste manqué et créature surgie des jeux obscurs de mots célestes, Icare est tout cela en même temps.
Parmi toutes les figures et les clés d’interprétation proposées par Jacques Lacarrière, chaque lecteur aura le choix : cette réflexion sur un mythe inusable est prétexte à un envol aussi savant qu’imaginatif.
Editions Seghers, Paris, 1993
ISBN 2232100243
Ce bel aujourd’hui
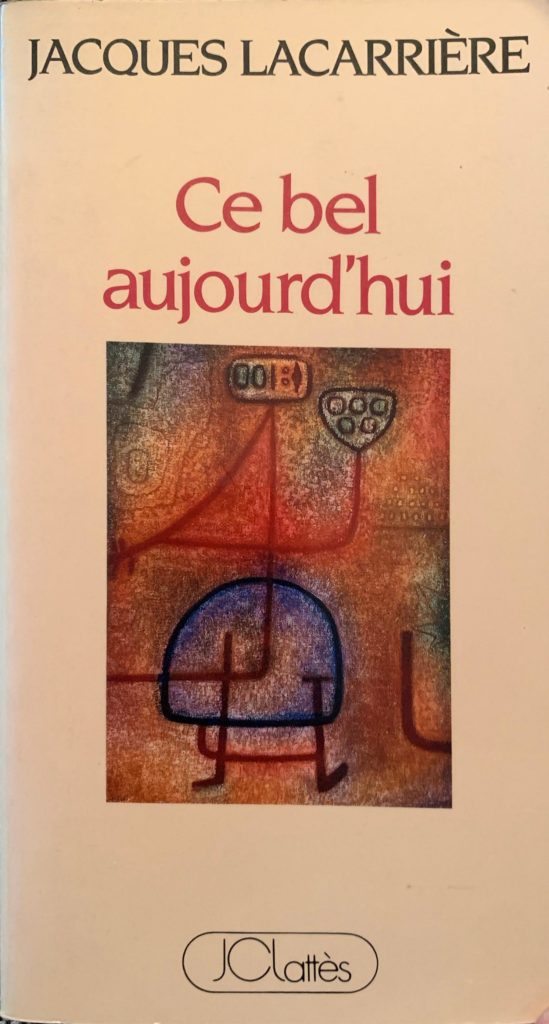
Je suis né dans un monde, un siècle et un milieu où les premiers objets que je perçus , quand je fus assez grand pour le faire, furent des Bugatti, et non des diligences, des avions Caudron et Bréguet et non des montgolfières.
Ces engins me parurent toujours familiers, je dirai même naturels et je me rendis compte en les voyant que la Beauté n’avait nullement déserté ce siècle mécanique, qu’Elle aussi pouvait habiter le métal, le verre ou le béton.
Il m’apparaît de plus en plus que ce monde moderne a un génie à lui, des inventions irremplaçables et des trouvailles qui auraient sûrement plu -ou n’auraient pas déplu- à Balzac ou Baudelaire.
De ces trouvailles, ces inventions, et ces beautés, j’ai voulu rendre compte en ce livre, cahier de rédaction, de lecture pour le temps présent et recueil des morceaux choisis de ma modernité.
Jacques Lacarrière
Editions Jean-Claude Lattès, Paris, 1989
ISBN 9782709607964
Ce bel et nouvel aujourd’hui
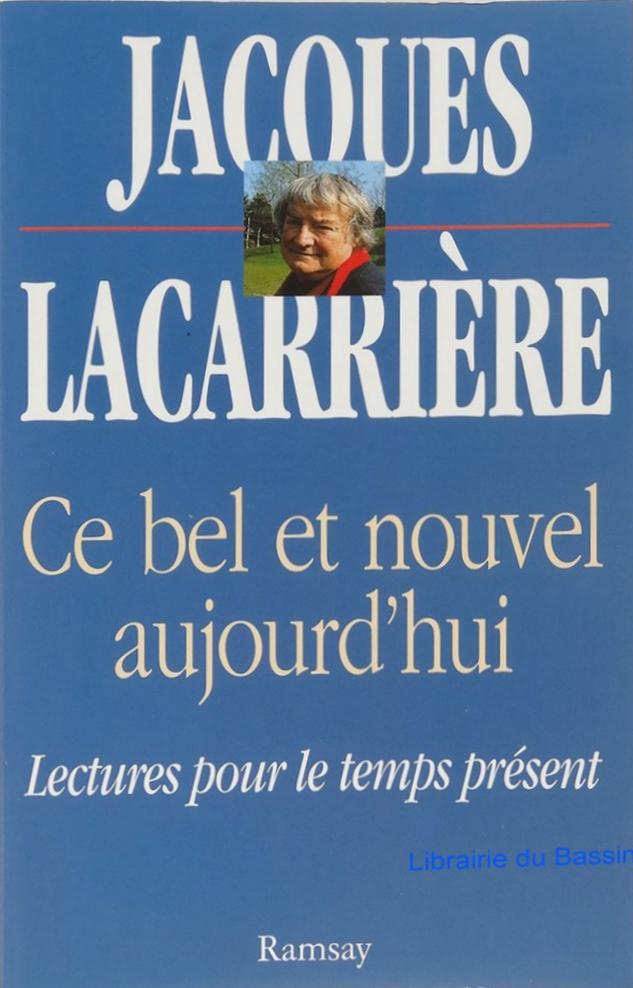
Téléphones portables, images virtuelles, surf et zapping sur les nouvelles ondes, manipulations génétiques et clonages, autant d’inventions qui fabriquent de nouveaux comportements, autant de mythologies qui se constituent à la porte du XXI: siècle.
Dix ans ont passé depuis Ce bel aujourd’hui, depuis les BD de Guy l’Éclair, depuis nos étonnements devant la prolifération des supermarchés, tankers et autoroutes. C’est pourquoi, une fois encore, Jacques Lacarrière porte sur les objets et les robots qui ne cessent d’envahir notre quotidien un regard averti, tout à la fois et d’ethnologue.
L’Éden fut-il le premier espace virtuel proposé à l’homme ? Dans quelle catégorie d’êtres ou d’objets célestes classer les satellites artificiels ? Qu’aurait pensé des mères porteuses Madame de Sévigné ?
Voilà quelques-unes des questions auxquelles répond l’auteur, sans complaisance ni parti pris, avec la finesse et l’humour du sage, comme un La Bruyère ou un Roland Barthes dans leur temps.
Editions Ramsay, Paris, 1998
ISBN 9782841143481
Dictionnaire amoureux de la Grèce
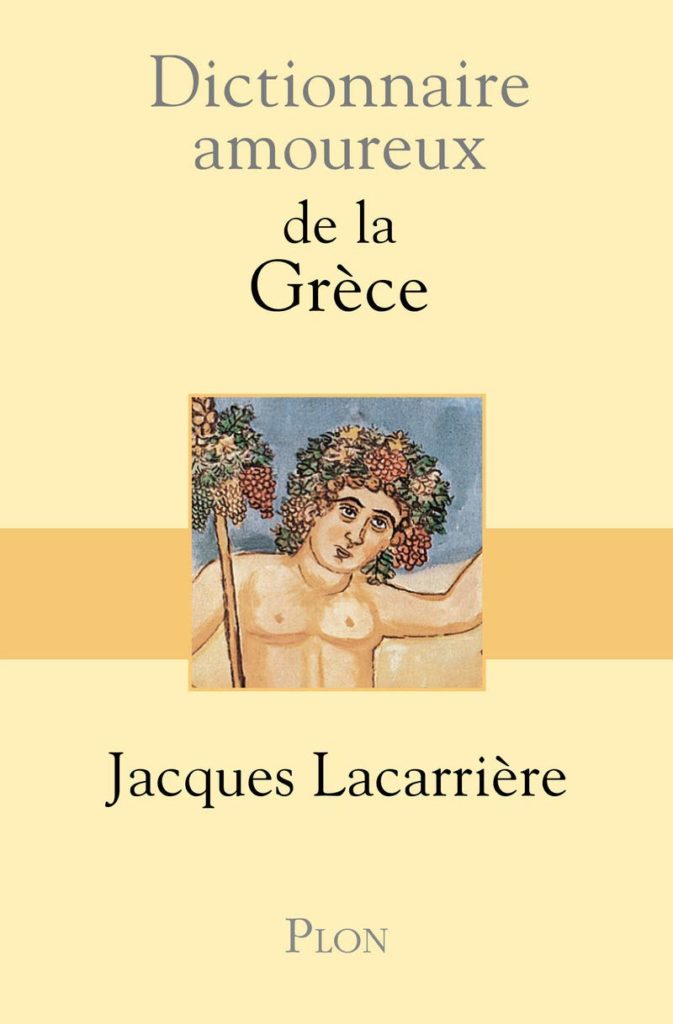
Un dictionnaire amoureux ? L’amour peut-il vraimant s’épeler de A à Z ou, lorsqu’il s’agit d’un dictionnaire amoureux de la Grèce, d’alpha à oméga ? Qu’auraient dit en leur temps Artémise, Aphrodite, Cléopâtre, Ismène et Théodora si je leur avais murmuré : vous êtes l’alpha ou vous êtes l’oméga de ma vie ? J’imagine déjà leur rire olympien ! Et pourtant, depuis que j’ai entrepris l’écriture de ce dictionnaire, j’ai rarement éprouvé un tel plaisir à construire, inventer un livre en choisissant amoureusement les mots qui
lui conviennent. A l’inverse de l’essai, du récit ou du roman, le dictionnaire n’implique aucune continuité dans son parcours et l’on peut parfaitement – ce qui fut mon cas – rédiger un texte sur Pégase sans être obligé pour autant de continuer par Périclès ! Ce type de livre procure donc une liberté à la fois totale et révélatrice. Totale dans la mesure où l’on est seul juge des mots à dire – ou en l’occurrence à écrire – et libératrice en cela qu’il permet de s’attarder sur des mots inconnus, oubliés, voire intimes et d’éviter, de refuser tout sujet stéréotypé, tout guide académique ou parcours universitaire. Cela devient et cela est un inventaire personnel, c’est à dire subjectif, de lieux, thèmes, objets, personnages réels ou légendaires, êtres et amis aimés. Il y a donc fatalement des absences qui ne sont pas des manques puisqu’elles sont volontaires et des présences inattendues.
En conclusion, je dirai que le principe du dictionnaire m’a permis de revisiter la Grèce et ma mémoire d’une façon totalement neuve. Pour moi, un tel ouvrage n’est pas fait de mots disant la vie, mais de vie traduite par des mots.
Jacques Lacarrière
Plon 2001
ISBN 2259190766
Méditerranée
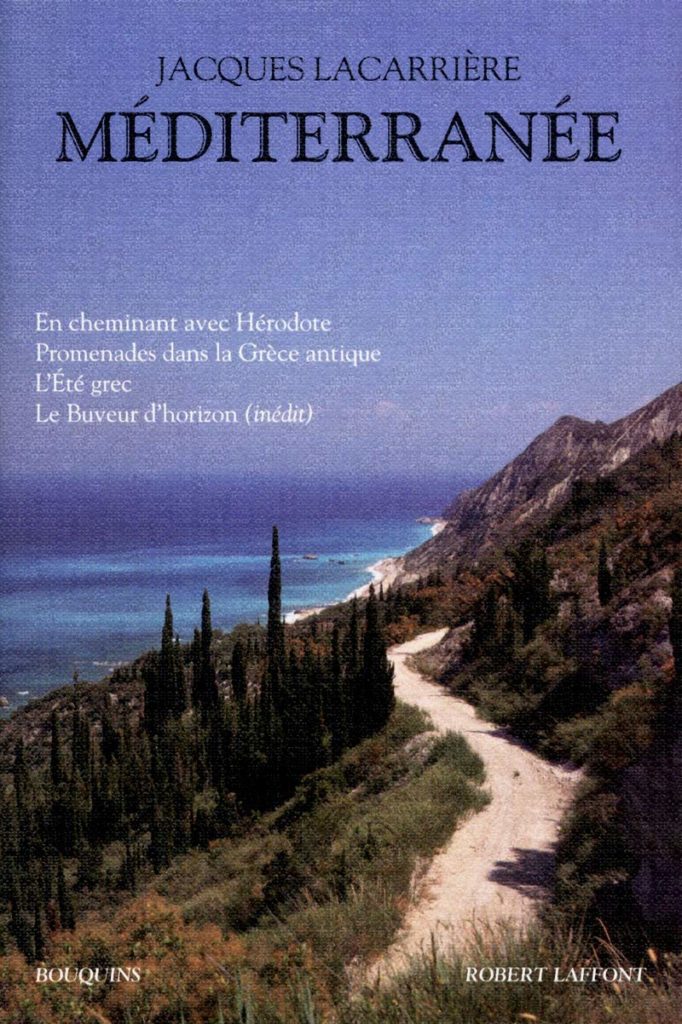
Cet ouvrage réunit pour la première fois les récits des voyages dédiés par Jacques Lacarrière à la Méditerranée : En cheminant avec Hérodote, Promenades dans la Grèce antique et L’Été grec, ainsi qu’une foule d’articles peu connus sur des îles grandes ou petites comme la Crète, Patmos, Hydra et tant d’autres.
Parution : 17 Janvier 2013
ISBN : 2-221-12494-4
Editions Bouquins / Robert Lafont
La plus belle aventure du monde
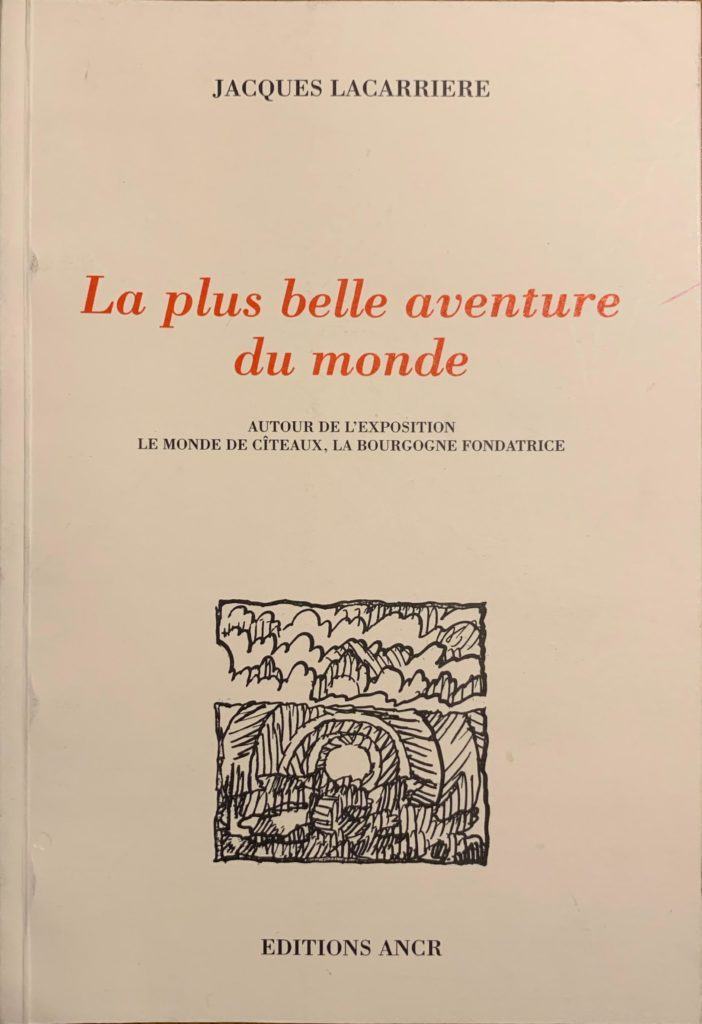
Vivant en Bourgogne, mais voyageur infatigable, Jacques Lacarrière est sans conteste l’un de ceux qui connaissent le mieux le monachisme occidental et oriental. Ecrit pour l’exposition «Le monde de Citeaux, la Bourgogne fondatrice», ce texte propose une réflexion sur l’aventure cistercienne, en la rapprochant des grandes utopies sociales des XVIIIe et XIXe siècles.
Ce livre est une relecture de l’aventure de Cîteaux, non pour en relater les différentes étapes, mais pour tenter de comprendre les raisons de son rayonnement, la portée et le sens de son message, à l’époque où elle a pris naissance, mais aussi la signification qu’elle peut avoir pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui et demain.
À la lumière de cette réflexion, Jacques Lacarrière examine rapidement d’autres tentatives de vie communautaire, restées à l’état de projet ou partiellement réalisées, au cours des siècles, et les causes de leur échec ou de leur réussite souvent éphémère.
L’aventure spirituelle collective est-elle encore possible dans les temps modernes ? Cette question est toujours d’actualité à l’aube du troisième millénaire.
Daniel Meiller
Editions ANCR, 1998, ISBN 2907376055
Editions Isolato, 2010, ISBN 9782354480202
Chemins d’écriture
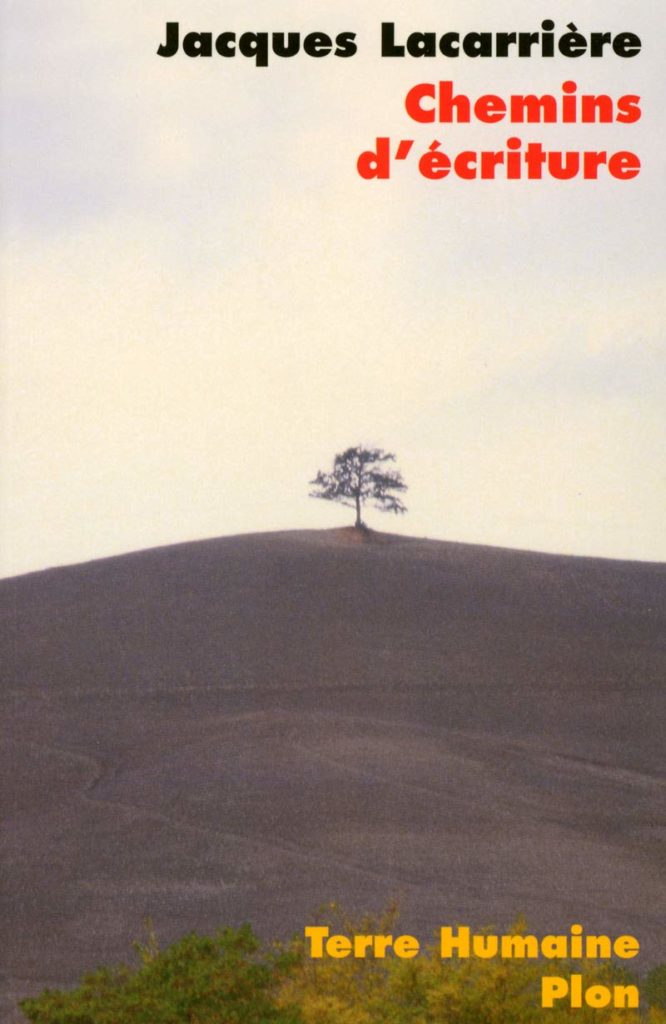
« Chemins d’écriture est avant tout l’itinéraire autobiographique et littéraire de quelques-uns de mes voyages et des livres auxquels ils donnèrent naissance. Les uns comme les autres ont jalonné ma vie au point d’en être le plus souvent indissociables. Voyages à travers la France avec Chemin faisant, années grecques avec L’Eté grec, séjours dans les déserts d’Egypte.avec Les Hommes ivres de Dieu et Marie d’Egypte, en Tunisie avec Sourates et en Turquie avec La Poussière du monde.
Errance et écriture ont été – et sont toujours pour moi – les deux voies majeures menant vers toute rencontre avec les autres et vers toute connaissance de soi-même. Si errer, comme je le dis quelque part dans ce livre, c’est d’une certaine façon s’enraciner dans l’éphémère, écrire, c’est essayer de capturer cet éphémère afin de le fixer et l’enfermer dans la durée, c’est se vouloir et devenir oiseleur du Temps.
Chemins d’écriture est le journal de cette fragile et hasardeuse alliance. «
Plon, 1988, 1991 et 2005
ISBN 978-2259202121













